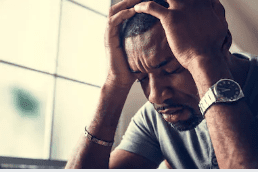
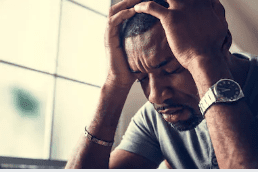
L’au-delà : cela signifie le mot ci-après. C’est-à-dire, ce qu’il y a (s’il y en a) après ici, après ici. Mais ici et après, dans l’ordre, ils disent le contraire, ils indiquent d’abord l’ici et ensuite l’après : et il faut dire immédiatement qu’Eastwood est beaucoup plus intéressé par l’ici que par l’après. Parce que c’est de cela, de la vie et non de l’au-delà, que parle son énième grand film.
Tant de vies, brisées par un tsunami ou une attaque dans le métro. Et bien d’autres vies, celles des survivants, de ceux qui ont été emportés et sortis de l’avalanche d’eau, de ceux qui n’ont pas grimpé, à cause d’un chapeau, sur ce chariot du métro, de ceux qui se retrouvent seuls après avoir perdu un proche, un frère jumeau, une épouse ou un père (violent). De ceux qui continuent à vivre laborieusement avec dans leur cœur la mémoire et le poids d’une personne qui est partie. La vie des survivants est au cœur de l’au-delà. L’au-delà des morts n’a pas grand-chose à voir avec cela : il est vu d’une manière confuse et diffusée, avec des ombres insaisissables et errantes, submergées par une lumière trop blanche comme dans un Hadès aveuglant, peut-être pacifié mais individuel, où chaque ombre n’a aucune relation avec les autres. L’au-delà que l’on aperçoit presque mort et qui apparaît comme en un éclair à George lorsqu’il serre ou même touche les mains d’une personne, cet au-delà si incertain, égal et éternel (monotone pour l’éternité ?), n’est pas au centre du film. Au centre, il y a la douleur de perdre quelqu’un qu’on aimait, ou même l’impossibilité d’oublier qui, quand il était vivant, vous a blessé au fond de vous.
Les existences sont entrelacées dans l’au-delà. Marie, présentatrice de télévision française, est submergée par la mer qui tombe sur le rivage, s’approche du seuil de cet au-delà lumineux et triste, commence à respirer à nouveau, revient vivre ici. Deux jumeaux vivent en symbiose, ils aiment et aident leur mère et quand l’un des deux, Jason, part, l’autre, Marcus, reste silencieux et fermé sur lui-même, mais courageux et prêt à tout pour « retrouver » son frère. Il y a aussi une Grecque qui a perdu sa femme et Mélanie, rencontrées à un cours de cuisine italienne (grand éloge pour le barbaresco…), qui disparaît quand George se réveille de son passé un horrible traumatisme caché. Parce que c’est la malédiction de George (et c’est le cœur du film) : pas tant pour entrer en contact avec l’avenir des morts, mais plutôt pour « voir » leur passé. Voir en elle aussi ce qui est inconcessible. Ce n’est pas l’au-delà qui intéresse Eastwood, mais ce qui pèse sur les personnages du passé et ne leur permet pas de vivre.
George veut guérir de sa malédiction, il ne veut plus « voir ». Eastwood, un narrateur très humain, le lui accorde. Il peut serrer la main sans être projeté dans les histoires d’un passé oppressant. Quand George commence à aimer quelqu’un, alors il peut vivre, en paix et ici, une histoire qui lui est propre. Ci-après est une invitation à vivre à l’intérieur du présent, à l’intérieur de ce qui se passe dans ce temps, dans le monde qui est le nôtre.
Dans le film, il y a un fil rouge qui unit les nombreux moments dans lesquels nous faisons référence à Charles Dickens. Avant de s’endormir, George se laisse bercer par une voix qui lit Dickens, puis se rend en pèlerinage chez le grand narrateur, puis rencontre à la foire aux livres le monsieur dont la voix lui lit Dickens chaque soir.
Là, parmi les livres, les histoires de George, Marie et Marcus s’entremêlent dans un final de Dickens dans lequel il est dit que pour vivre notre histoire, il faut enlever la douleur de ses épaules, enlever son chapeau, embrasser, laisser les morts dans leur lumière aveuglante et nous vivre dans notre lumière tranquille du quotidien.
C’est comme si Eastwood disait, avec l’un de ses films si simple, si lisse, si séduisant et si doucement humain même quand ils parlent de douleur et de mort, que l’important est de vivre ici et de ne pas chercher plus loin, de se rappeler qui nous a quitté sans s’accrocher à lui, sans vouloir le tenir en retrait. Avoir, encore et encore, une histoire à vivre, c’est ce qui nous fait vraiment vivre. C’est seulement dans cette existence que nous vivons des histoires. Dans la trop grande lumière d’un au-delà immobile, il n’y aura plus d’histoires.
Eastwood fait quelque chose de plus : c’est ironique. Il nous dit que nous pouvons vivre beaucoup d’histoires dans les livres ; il ajoute qu’il y a des conteurs et des écrivains qui peuvent raconter des histoires ; il suggère qu’il y a d’autres conteurs qui manquent de ce don. Dickens est l’auteur ouvertement recommandé. Le nom de Rousseau apparaît aussi dans le film : c’est le nom d’un médecin qui sait écouter les histoires de ceux qui n’ont pas encore abandonné la vie, un médecin qui vit en pleine nature dans les montagnes (peut-être le même Suisse que Jean-Jacques). Eastwood ajoute un troisième nom à ce jeu littéraire qui se cache dans les plis du film, celui de Joyce, l’attribuant à une fausse voyante qui triche. Question : N’est-ce pas le narrateur classique Clint Eastwood et son excellent scénariste Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon, The Two Presidents) qui ont voulu nous dire qu’une bonne histoire comme Dickens et une attitude sereine comme Rousseau sont des guides sages et utiles pour vivre ici et maintenant (ajoutant aussi, en passant, que Dickens fonctionne mieux que Joyce) ?












